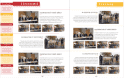Deux ha de prés transformés en vigne

Didier Grappe est installé sur 3,5 ha de vigne à Saint-Lothain. Il mène ses parcelles en mode biologique et vinifie avec le moins d'interventions possibles, sans ajouts de souffre et de levures, sans tanisage, ni chaptalisation. Il aura suffit de deux ou trois articles signés de journalistes influents pour que ses vins trouvent un marché. « Je vends 70% de ma production à l'exportation vers les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Australie , uniquement par le bouche à oreille entre importateurs. Je ne fais pas beaucoup de salons, je préfère passer du temps dans les vignes et en cave. » Il n'en reste pas moins que le viticulteur aimerait trouver un peu plus de foncier pour répondre à la demande. Il pense aussi à son fils de 16 ans, en BPREA vigne, qui pourrait avoir le projet de s'installer. La perle rare Après quelques recherches infructueuses, Didier Grappe trouve la perle rare : 2 ha de prés bien exposés, qui plus est sur sa commune. « C'est un coteau qui va très bien pour faire de la culture biologique, pleine bise, bien venté et qui ne reste jamais dans la rosée car il voit le levant et le couchant. La terre est reposée et bien f...
La suite est réservée à nos abonnés.